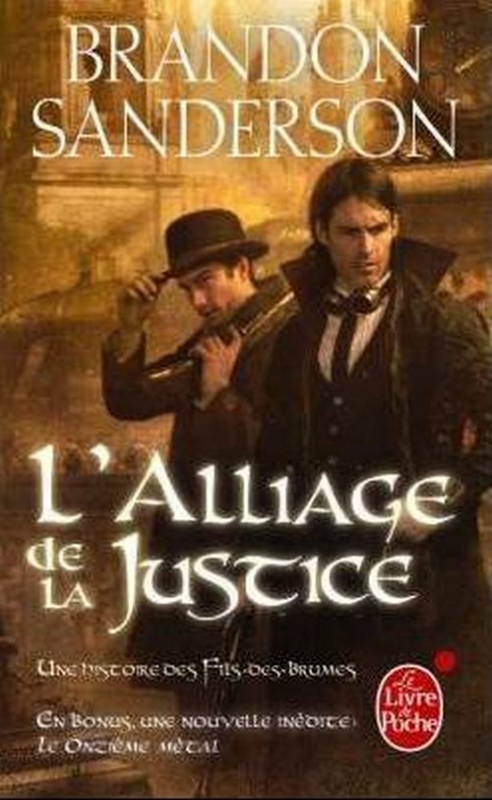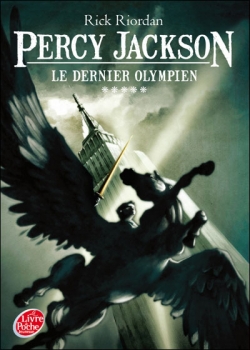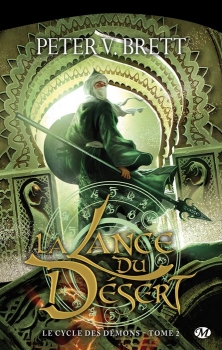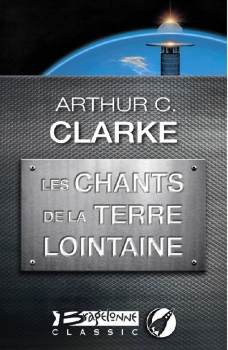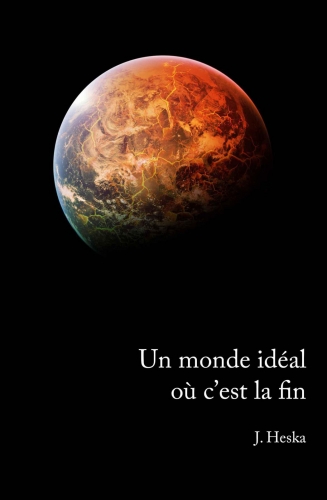L'auteur : Adriana Lorusso est née en 1946 à Treviso (Nord-Est de l'Italie). Ayant été traductrice, elle a joué un rôle important dans la traduction de ses manuscrits de l'italien vers le français. Elle vit à Bruxelles. La saga Ta-Shima comprend deux tomes et un recueil de nouvelles.
Tome 1 : Ta-Shima
Présentation de l'éditeur : Pendant huit siècles, la planète Ta-Shima est restée à l'écart de la Fédération des mondes humains. Deux races humaines très différentes mais complémentaires y coexistent : les Shiro, seigneurs arrogants et sanguinaires, prêts à s'entre-tuer pour une simple question d'honneur et les Asix, trapus et velus, qui vouent aux Shiro une admiration sans borne et que ceux-ci doivent protéger en toute circonstance. Mais l'équilibre entre les deux races est bien plus subtil qu'il n'y paraît, comme le découvrent peu à peu l'ambassadeur de la Fédération et sa suite. La dirigeante de Ta-Shima étant morte dans un accident plutôt suspect, les membres du conseil décident de rappeler sur leur monde une doctoresse rebelle, Suvaïdar Huang. Mais Suvaïdar n'a aucune envie de rentrer à la maison : la vie est nettement plus commode sur les planètes hyperdéveloppées de la Fédération. Sous la pression des évènements, elle sera néanmoins obligée de s'enfuir pour Ta-Shima, en compagnie de son frère. Parviendra-t-elle à abandonner ses habitudes étrangères pour redevenir une authentique Shiro ? Et découvrira-t-elle le secret de Ta-Shima, qui doit être protégé à tout prix ?
La Sadaï, dirigeante de Ta-Shima, meurt dans une explosion. Le nouveau Conseil ne croit pas à l'accident, et soupçonne les Extramondins, c'est-à-dire la Fédération de 127 planètes qui a redécouvert Ta-Shima il y a peu. Quelqu'un s'est arrangé pour que la Sadaï soit accompagnée par deux de ses fils. Il s'agirait donc d'un attentat contre la lignée de la Sadaï et il n'y a bien que les Extramondins pour croire qu'une fonction peut être héritée. Ces soupçons se précisent quand deux autres enfants naturels de la Sadaï, Oda et Suvaïdar, sont poursuivis par les services secrets de la Fédération. Pour la suite de ses rapports avec les Extramondins, le Conseil a besoin de les comprendre et doit faire appel à Suvaïdar, seule de son peuple à avoir vécu intentionnellement dans l'Extramonde.
Parallèlement, le nouvel ambassadeur et la majorité de sa suite sont pleins de préjugés et persuadés que leur devoir est d'apporter la civilisation à Ta-Shima. Ces sauvages manquent du confort le plus élémentaire, ne maîtrisent pas la langue universelle et n'ont jamais entendu parler de la religion unificatrice. Suvaïdar est la seule qui puisse faire tampon dans le choc des cultures. Elle doit empêcher que les incompréhensions mènent au conflit généralisé qui signifierait l'annihilation des Ta-Shimoda : si les Shiro placent toujours leur honneur avant leur survie, la protection des Asix est leur priorité. Mais le risque est grand car il y a un aspect au coeur de l'existence Ta-Shimoda qui à lui seul peut pousser la Fédération à prendre les armes.
J'ai trouvé ce premier tome enthousiasmant, mais il n'est pas dénué de défauts. Le premier d'entre eux : la longueur. Il me paraît évident que le roman aurait pu être grandement raccourci tout en gardant ses qualités : à défaut d'être supprimées, certaines digressions auraient du au moins être écourtées. Celles-ci s'accompagnent presque systématiquement de ralentissements dans la progression du récit, le plus souvent à coups de descriptions, qui n'apportent rien au développement de ce tome - et dont on imagine difficilement qu'ils puissent se justifier dans le suivant. Quant au deuxième aspect qui m'a paru insatisfaisant, il m'est plus facile de le présenter en passant d'abord par les points forts du livre.
La description du choc des civilisations fonctionne très bien. Le sentiment d'étrangeté entre les deux cultures est mis en scène adroitement, à travers des dialogues ou réflexions personnelles de certains personnages sur une multitude de sujets, y compris les plus quotidiens : cela va des conventions à table et du mobilier à la notion de famille (ou son absence), la place de la femme dans la société (et le gouvernement), ou la sexualité. C'est ainsi que certains personnages et le lecteur mettent plus ou moins rapidement à jour la différence fondamentale entre le pragmatisme poussé à l'extrême sur Ta-Shima et une conception de la vie plus familière pour le lecteur occidental du côté de la Fédération (si l'on excepte certains excès de zèle religieux/moral). L'incompatibilité apparemment insurmontable entre les deux cultures s'exprime même par la présence de certains concepts chez les uns qui sont totalement absents chez les autres, ce qui se manifeste dans une difficulté supplémentaire : la barrière de la langue.
"[Suvaïdar] n'arrivait pas à décrire à ses compatriotes la réalité [d'autres mondes], elle se heurtait toujours à des problèmes sémantiques, ou à leur difficulté à comprendre comment pouvait fonctionner une société si différente de la leur"
L'aspect linguistique du problème est trop souvent oublié ou carrément exclu d'office par le miracle d'une langue unique dans une galaxie entière. Si ici le problème semble circonscrit à la planète Ta-Shima, c'est déjà bien de l'avoir souligné. C'est aussi dommage de ne pas l'avoir exploité d'avantage.
Autre satisfaction : le personnage de Suvaïdar qui est bien traité pendant la quasi-totalité du roman. Gênée par certains points de sa propre culture, elle s'était exilée pour aller voir si l'Extramonde lui allait mieux. Sa reprise de contact avec les coutumes qui la mettaient mal à l'aise sont intéressants. Ils sont l'occasion de se familiariser avec la société Ta-Shimoda. Ils sont aussi l'occasion pour Suvaïdar d'y réfléchir de nouveau, à la lumière de son expérience au contact de la Fédération. En réapprenant petit à petit à être une Shiro authentique, elle passe par un certain nombre de crises aussi bien envers sa propre culture que celle de l'Extramonde à laquelle elle n'avait finalement jamais pu s'adapter. Si elle est la plus à même de saisir les racines du problème entre Ta-Shimoda et Extramondins, c'est parce qu'elle est elle-même l'incarnation du choc des cultures.
Pour retrouver sa place, Suvaïdar doit en passer par une réflexion profonde sur sa propre culture. C'est là qu'intervient "le plus grand secret de Ta-Shima". Confusément consciente que quelque chose lui échappe, Suvaïdar en vient à approfondir un aspect reconnu comme normal sur Ta-Shima (et déstabilisant pour le lecteur). Paradoxalement, c'est une péripétie de cette enquête qui permet de renouer (maladroitement, il faut le dire) avec les évènements du début du roman et "l'accident" de sa mère biologique, qui avaient été complètement mis de côté pendant la majorité du récit (mais mon sentiment est que ce n'a jamais été l'enjeu de ce premier tome).
Arrive alors, à la fin du roman, ma deuxième grande insatisfaction. Pour des raisons que je ne peux donner sans spoiler, Suvaïdar en vient à prendre une décision radicale et à opérer un choix quant à sa culture et sa place dans le monde. Mais ce dénouement manque de crédibilité : trop soudain, il semble également peu cohérent avec l'évolution du personnage au cours du roman, qui avait pourtant été traité relativement bien jusque là. Ce point laisse un goût quand même un peu amer. Cela dit, tout n'est pas perdu puisqu'on peut espérer que le deuxième tome fasse la lumière sur cet aspect, ou le rectifie. Bref, il faut espérer que cette conclusion soit bien gérée dans la suite du cycle. Personnellement, l'intérêt suscité par ce premier tome m'encourage à donner sa chance au deuxième tome.
 |
Illustration :
Stephan Martinière |
Présentation de l'éditeur : Sur Ta-Shima, l'ambassadeur de la toute-puissante Fédération des mondes humains a décidé d'explorer la planète en compagnie de sa seconde épouse et de sa fille. Le jeune Rinvar, adolescent orgueilleux et champion de sabre, a été choisi pour les accompagner, à son grand déplaisir. Mais les choses ne se passent jamais comme prévu sur ce monde étrange et dangereux, que seuls les Shiro et les Asix ont réussi à apprivoiser. Et les coutumes, en particulier sexuelles, des uns et des autres sont sources de malentendus sans nombre...
Pendant ce temps, les espions de la Fédération cherchent par tous les moyens à réduire l'autonomie de Ta-Shima et à forcer ses habitants à rejoindre la civilisation humaine. La doctoresse rebelle Suvaidar Huang, qui tire les ficelles de la politique locale, doit protéger à tout prix les secrets des généticiennes Jestak. Mais le prix à payer ne sera-t-il pas trop élevé ?
Suvaidar a donc décidé d'accepter et de protéger le secret de Ta-Shima. Cette décision, surprenante à la fin du premier tome, est pourtant celle qui permet à cette suite de gagner toute son intensité.
La société de Ta-Shima est menacée. Le plus grand danger, c'est que la Fédération décide purement et simplement de se lancer dans un génocide par extrémisme. Mais même si cela ne va pas jusque là, il y a aussi le risque pour la planète d'être simplement intégrée à la Fédération, signant la fin du mode de vie des Shiro et des Asix à plus ou moins long terme et plus ou moins violemment.
Parce qu'elle s'était elle-même exilée au sein de la Fédération et parce qu'elle connaît le secret de Ta-Shima, Suvaidar est la seule à appréhender totalement le danger qui pèse sur son peuple. Elle seule est alors capable d'anticiper certains problèmes qui pourraient se poser dans les interactions avec l'ambassadeur et sa suite. Autant dire que la visite de Ta-Shima par celui-ci, sa deuxième femme, sa fille et le docteur Li Hao est à hauts risques. Comme si ça ne suffisait pas, on apprend aussi que quelqu'un au sein des services spéciaux de la Fédération commence à s'intéresser de plus près à Ta-Shima. Quelqu'un va-t-il découvrir le secret des Jestak ? Quelles en seraient alors les conséquences ?
Ce deuxième tome fait jouer à fond la tension sur ce sujet. Avec les situations à risque et des personnages qui s'approchent beaucoup de la vérité, l'auteur joue continuellement avec les nerfs du lecteur. Dans le même temps, un phénomène plus subtil se développe progressivement : la mise en contact de ces deux civilisations et modes de pensée ne peut pas être sans effet. Suvaidar ne peut pas rester la seule dont la mentalité évolue à cause de sa familiarité avec les deux cultures. Et à vrai dire on se dit souvent à la lecture que ça vaudrait mieux. Les deux civilisations présentent des caractéristiques parfois franchement repoussantes, même si la palme revient aux habitants de Ta-Shima - mais il faut dire que leur culture est à l’origine très étrangère à celle du lecteur.
Bref ce deuxième tome fonctionne plutôt bien. Au final, l’auteur livre un planet-opera qui ne révolutionne pas le genre mais qui se tient, avec ce qu’il faut d’attention et de soin portée aux points les plus importants.